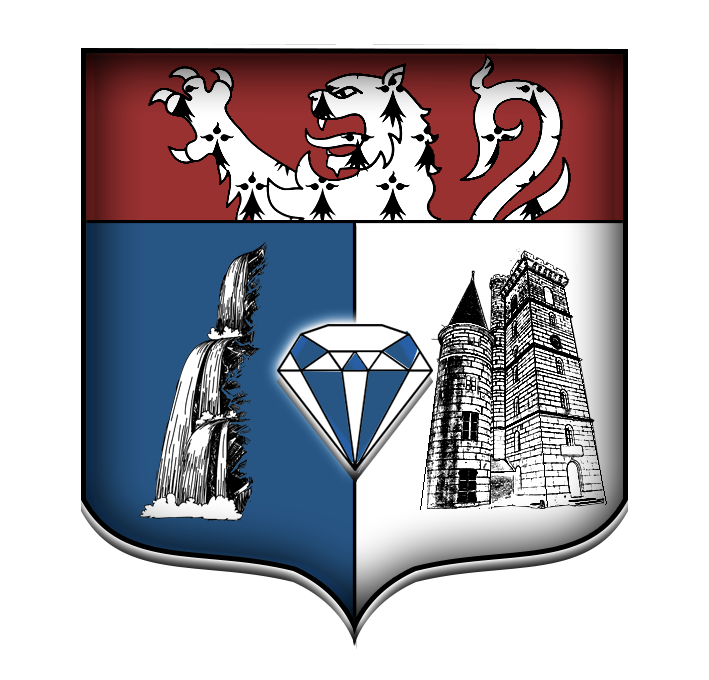Les glacières de Sylans
Le premier document mentionnant l'usage de la glace est une chanson chinoise du Vème siècle.
Au temps des Romains, les aliments, comme le poisson, étaient transportés jusqu'à Rome dans de la glace et des fourrures.
Le commerce de la glace apparait au XVIème siècle.
Puis au XIXème siècle les glacières privées sont remplacées par les entreprises commerciales. Inventé en 1876, le réfrigérateur mit fin progressivement à la glace naturelle.
Sylans est un lac situé près de Nantua alimenté par le ruisseau de Charix. Une bulle du pape Eugène III le nomme dans une confirmation de privilèges à l'Abbaye de Nantua en 1145.
Il est d'une surface d'environ 49 hectares, d'une longueur d'environ 2 kilomètres sur 250 mètres de large et d'une profondeur maximale de 22 mètres. Son eau est d'une pureté car peu minéralisée, eau cristalline qui se teinte parfois en vert. Il est maintenant prisé des pêcheurs pour ses brochets, carpes...
Le site des glacières de Sylans, unique en France, est visible depuis l'autoroute des Titans.
Joackim MOINAT nait à Cerdon le24 mars 1830 à Cerdon, fils de parents propriétaires. A son mariage avec Marie Ermance CURTET le 20 novembre 1859 il est limonadier à Nantua. Ce propriétaire du café du Paradis à Nantua, souhaite rafraichir les boissons de ses clients. Il décide donc en 1864, d'extraire de la glace au lac de Sylans, très pur et peu ensoleillé. L'hiver la température descend jusqu'à moins 20 degré l'hiver l'endroit est idéal. Le lac gèle de décembre à mars. La glace peut atteindre entre 15 et 40 centimètres d'épaisseur.
En 1864, il construit une cabane en bois pour conserver la glace extraite. Puis pour la stocker des puits à glace enterrés ou semi enterrés sont utilisés.
La demande explose, l'entreprise florissante, Joachim remplace sa cabane par une plus grande avec des parois isolées.
En 1869, il construit une véritable glacière et aménage un chemin jusqu'à la route Lyon-Genève.
Les bâtiments de la grande glacière, implanté à l'endroit le moins ensoleillé du site, sont impressionnantes : 140 mètres de long, 30 mètres de large et 12 mètres de haut. La capacité de stockage est de 40 000 tonnes, voir 70 000 tonnes. La conservation de la glace est impressionnante ! Celle expédiée fin 1916 est celle exploitée pendant l'hiver 1914/1915.
Il vend son café le Paradis en 1871 et se consacre à ses deux entreprises : le Buffet de la Gare à Bourg en Bresse et la glacière.
La Préfecture de l'Ain l'autorise officiellement à exploiter la glace du lac en 1873.
Les paysans des alentours viennent compléter leurs revenus, ceux du Poizat par le sentier de la Soupe. Suivant l'enneigement, certains après une heure de trajet, les barbes et moustaches blanchissent et gèlent. Ils portent des bottes en cuir avec semelles de bois. Ils travaillent 7 jours sur 7 jours dans le froid. Une petite baraque en bois se situe près de la voie ferrée pour les plus éloignés sur le lac. Les autres mangent dans la cantine des bâtiments.
Le départ du chantier est donné par un drapeau hissé sur le bâtiment principal et la sonnerie d'une corne de brume. Une trentaine d'employés travaillent toute l'année. L'effectif peut atteindre 300 personnes au plus fort de l'exploitation en 1879.
Les chevaux tirent une charrue à trois socs qui entaillent la glace pour aménager un canal de huit mètres de large. Il permet d'amener les blocs jusqu'au rivage. Des bandes de glace de quatre mètres sont découpées avec la charrue, puis découpées à la scie en bloc. Un homme avec une perche munie d'un crochet convoie le bloc par flottaison vers la berge, où il est récupéré. Là, il est débité, toujours à la scie en bloc d'un mètre carré. Les blocs sont convoyé vers la glacière. Un tapis roulant, activé par une machine à vapeur, monte les pain de glace dans les étages pour être stockés automatiquement en attendant leur expédition.
Les blocs de glace sont expédiés dans des cadres en bois, isolés avec 20 à 30 cm de paille. Puis le conditionnement se fait dans des toiles de jute recouverte de paille.
Le au chemin de fer PLM arrivant de La Cluse pour Bellegarde sur Valserine en 1882, il fait raccorder les rails jusqu'à l'usine en 1883. Deux voies sont exploitées. Cela permet l'envoi de sa production à Lyon, Paris, Toulon et même Alger.
Jean MOINAT vend la glacière de Sylans à la société des glacières de Paris le 17 janvier 1884. Il meurt de maladie le 14 avril 1890 à Nantua.
Les glacières de Paris est fondée en août 1865. L'entreprise se fournit à Sylans, elle connait donc le site.
La production se développe rapidement. Ce sont entre 20 et 30 wagons de 10 tonnes qui quittent Sylans chaque jour. Ils sont acheminés de nuit. La perte est inévitable ! Sur 10 tonnes de glace seules 8 arrivent à Paris.
De 1869 à 1900, les bâtiments en bois disparaissent, remplacés par 4 glacières en pierres. Elles sont plus isotherme et limitent le transfert de chaleur.
En 1905 une dalle en béton armé est coulée sans rien démonter. Cette dalle est recouverte de paille afin d'améliorer l'isolation. Des ouvertures coté Nord sont réalisées. A coté sont construits des bâtiments servant de cantine, de poudrière, d'écurie, ateliers et bureaux.
A partir de 1910, l'activité ralentit et décline. les hivers sont moins froid et la glace artificielle fait son apparition. Les hommes sont réquisitionnés pour la guerre. Jusqu'en 1916, l'expédition est limité 2 ou 3 wagons par semaine. L'arrivé du réfrigérateur et le manque d'hommes dans les villages ont eut raison des glacières.
Les glacières de Paris rendent le terrain et les bâtiments aux communes propriétaires et abandonnent le site après une dernière production du 30 janvier au 10 février 1917. Après la guerre, les machines ont été démontées et expédiées.
Il ne reste aujourd'hui que les ruines visitables uniquement à l'extérieur. Il est possible d'avoir une visite guidée sur réservation à l'office du tourisme Haut-Bugey.
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com
Les Glacières de Sylans en cartes postales
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com